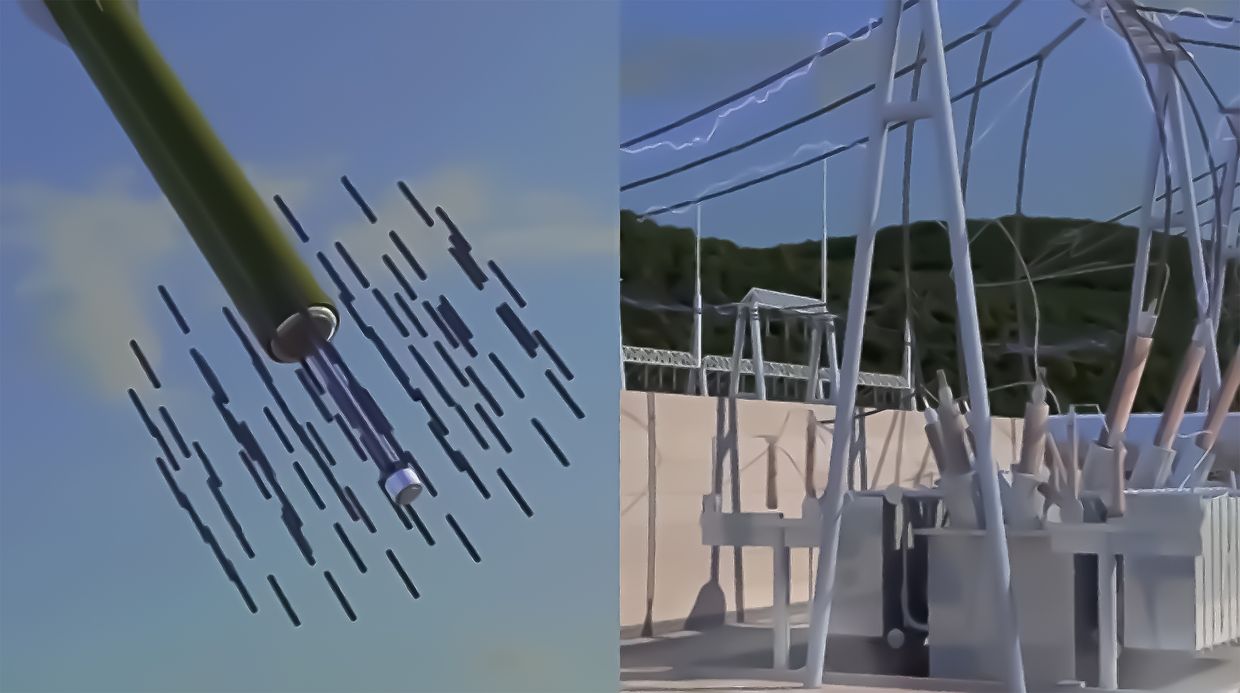Quand l'aide humanitaire s'arrête dans un camp de réfugiés : une étude kényane révèle des conséquences dramatiques
Les besoins humanitaires augmentent dans le monde entier, tandis que les principaux donateurs comme les États-Unis et le Royaume-Uni réduisent leur soutien. Cette situation met à rude épreuve des systèmes d'aide déjà surchargés. Depuis 2015, les besoins humanitaires mondiaux ont quadruplé, en raison des nouveaux conflits au Soudan, en Ukraine et à Gaza, ainsi que des crises prolongées au Yémen, en Somalie, au Soudan du Sud et en RD Congo. Pourtant, les fonds des donateurs ne suivent pas, couvrant moins de la moitié des 50 milliards de dollars demandés pour 2024. Récemment, les États-Unis ont réduit de plusieurs milliards de dollars leur aide aux efforts de secours mondiaux, qui représentait autrefois jusqu'à la moitié de tous les financements humanitaires publics et plus d'un cinquième du budget de l'ONU. D'autres donateurs ont également réduit leur aide. Face à ces pénuries de financement, les agences humanitaires sont confrontées à des choix difficiles : réduire l'échelle des opérations, suspendre des services essentiels ou annuler des programmes. Les perturbations dans la distribution de l'aide sont devenues monnaie courante, mais peu d'études rigoureuses ont documenté leurs conséquences sur les populations affectées. Une étude récente menée dans l'un des plus grands camps de réfugiés au Kenya, Kakuma, comble cette lacune. Notre équipe de recherche de l'Université d'Oxford et de l'Université d'Anvers a étudié l'impact d'une réduction de 20 % de l'aide en 2023. Les résultats montrent des effets dramatiques sur la faim, la détresse psychologique, les systèmes de crédit locaux et les prix des biens. Le camp de Kakuma abrite plus de 300 000 réfugiés, principalement originaires du Soudan du Sud (49 %), de Somalie (16 %) et de RD Congo (10 %). La plupart dépendent à plus de 90 % de l'aide humanitaire pour survivre. Avant la réduction, les réfugiés recevaient 17 dollars par mois en transferts monétaires et en nature, à peine suffisants pour couvrir les besoins de base. L'étude a suivi 622 ménages de réfugiés sud-soudanais pendant un an, recueillant des données mensuelles sur leurs conditions de vie. Les chercheurs ont également collecté des données hebdomadaires sur les prix de 70 biens essentiels et mené plus de 250 entretiens approfondis. La réduction de 20 % de l'aide en juillet 2023 a entraîné une augmentation de l'insécurité alimentaire, avec une baisse de 7 % de l'apport calorique moyen. La part des ménages ne mangeant qu'un repas ou moins par jour a augmenté de 8 points de pourcentage. Les réfugiés ont également réduit la diversité de leur alimentation pour compenser la perte de revenus. Le système de crédit informel, essentiel pour de nombreux réfugiés, s'est effondré. Les commerçants, craignant des défauts de paiement, ont réduit leurs prêts de 9 %. Les ménages ont dû vendre leurs biens et puiser dans leurs réserves alimentaires, entraînant une baisse de 6 % de la valeur moyenne des actifs des ménages. La détresse psychologique a également augmenté, avec une baisse auto-déclarée de la qualité du sommeil et du bonheur. Paradoxalement, la baisse de la demande a entraîné une diminution des prix des denrées alimentaires, atténuant partiellement les effets négatifs de la réduction de l'aide. Cette étude souligne deux implications politiques majeures. Premièrement, l'aide dans des contextes comme Kakuma ne doit pas être considérée comme facultative, mais comme une nécessité structurelle. Des mécanismes doivent être mis en place pour protéger les réfugiés des retraits abrupts des donateurs. Deuxièmement, le crédit informel joue un rôle central dans la vie économique des camps. Les programmes de transferts monétaires doivent tenir compte de ces dynamiques pour éviter l'effondrement de systèmes déjà fragiles.