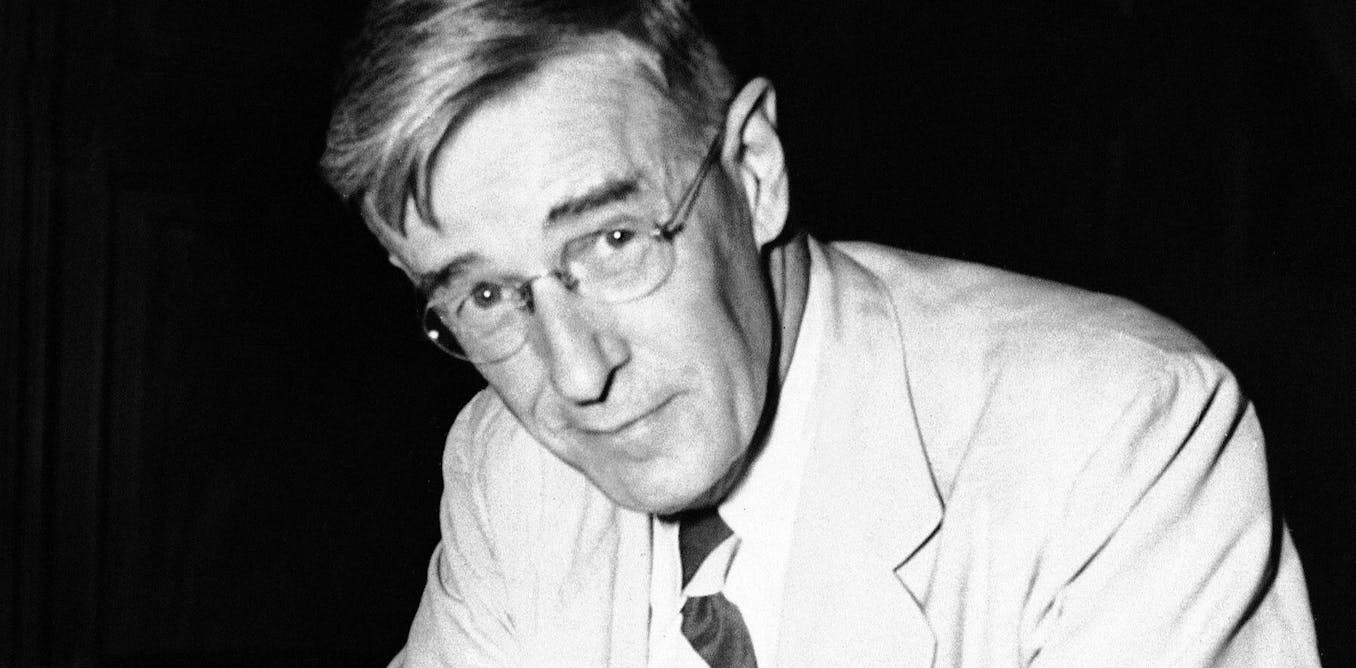La science américaine au bord d'une hémorragie cérébrale historique
Au cours du 20e siècle et du premier quart du 21e siècle, les États-Unis sont devenus un leader mondial en science, technologie, santé et éducation grâce à des investissements massifs dans la recherche. Mais en 2025, ce paysage change radicalement : des coupes budgétaires fédérales sans précédent, la fermeture d'institutions et la réduction drastique des financements menacent d'anéantir la science américaine. Tout comme l'exode des scientifiques de l'Allemagne nazie avait profité au reste du monde, les décisions actuelles des États-Unis pourraient bien offrir un cadeau similaire à la communauté scientifique internationale. Voici le récit d'un témoin privilégié.
Depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 2024, les États-Unis régnaient sans partage sur la science mondiale. Physique, astronomie, biologie, médecine – toutes les disciplines bénéficiaient de missions et d'initiatives américaines, souvent en collaboration avec des partenaires internationaux. Ce modèle, fondé sur les faits scientifiques et l'intérêt public, a engendré des décennies de progrès. Mais depuis janvier 2025, cette dynamique s'est brutalement interrompue.
Les plus prestigieuses institutions scientifiques – NOAA, NASA, NSF, CDC, EPA, FDA – subissent des attaques internes inédites. Des financements sont supprimés, des bourses annulées, des contrats rompus. Des milliers d'employés licenciés, parfois en violation de décisions de justice. Le nouveau budget, qui devrait être adopté mi-2025, sonnerait le glas de la recherche dans les universités et laboratoires nationaux. Pour les scientifiques américains, c'est un cauchemar devenu réalité.
Pourtant, il reste une lueur d'espoir. Dans les années 1930, la purge des scientifiques par Hitler avait finalement profité aux autres nations, au point qu'on parlait de « cadeau d'Hitler ». Aujourd'hui, si la science américaine s'effondre, le reste du monde pourrait en tirer bénéfice. Le récent congrès de la Société américaine d'astronomie à Anchorage en juin 2025 en a offert un aperçu saisissant : habituellement consacré aux avancées scientifiques, il s'est transformé en forum de crise où chercheurs et étudiants cherchaient désespérément des solutions.
Les chiffres sont alarmants : la NASA a licencié 2 500 employés et envisage 3 000 départs supplémentaires, principalement dans sa division scientifique qui subirait une coupe de 47 %. La NSF, pilier de l'astronomie au sol, perd 1 800 employés et 1 700 subventions, avec une réduction budgétaire de 57 %. Sur 124 missions spatiales en cours, 41 pourraient être purement annulées. Ces coupes touchent toutes les disciplines, de la biologie à la météorologie, frappant particulièrement les jeunes chercheurs dont les opportunités s'amenuisent.
Le parallèle avec l'Allemagne des années 1930 devient troublant lorsque l'administration Trump rompt les abonnements à des revues scientifiques prestigieuses comme Nature, les qualifiant de « wokes » et « corrompues » – un écho sinistre à l'interdiction des mêmes publications par les nazis. Mais comme le démontre l'histoire, la science survit toujours. L'exode des cerveaux allemands avait alors profité aux États-Unis et au Royaume-Uni ; aujourd'hui, l'Europe, le Japon et le Canada se positionnent pour accueillir les scientifiques américains.
Face à cette crise, deux stratégies émergent. Le « Plan A » consiste à se battre dans le système : lobbying politique, mobilisation publique, soutien aux candidats pro-science. Mais même en cas de succès, les dégâts seront considérables. D'où la nécessité d'un « Plan B » : chercher des opportunités à l'étranger. L'Europe a déjà débloqué près d'un milliard de dollars pour attirer les talents américains, le Japon 100 milliards de yens, tandis que la France et d'autres pays développent des programmes spéciaux.
Les projets scientifiques menacés pourraient aussi trouver refuge ailleurs. Les télescopes spatiaux pourraient être transférés à des agences partenaires, les observatoires terrestres délocalisés – comme le TMT qui pourrait s'installer aux Canaries plutôt qu'à Hawaï. L'ESA, la JAXA ou l'Agence spatiale canadienne ont parfaitement les capacités de reprendre le flambeau. La science est une entreprise globale, et si les États-Unis abandonnent leur leadership, d'autres nations sont prêtes à prendre le relais.
Bien qu'il faille continuer à défendre la science aux États-Unis, où elle reste prééminente à bien des égards, les récentes coupes budgétaires n'ont rencontré qu'une résistance symbolique. Si cette tendance se confirme, 2025 ne marquera pas seulement la fin de l'exceptionnalisme scientifique américain – elle pourrait déclencher un exode des cerveaux qui éclipserait le « cadeau d'Hitler » par son ampleur et ses conséquences pour les générations futures.