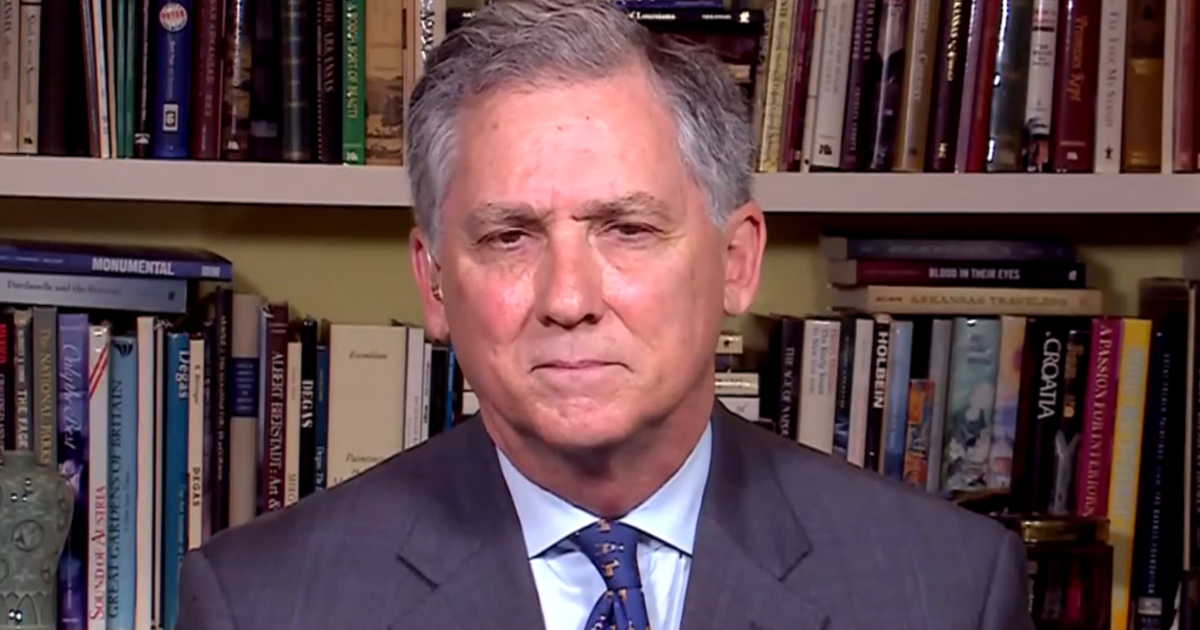Trump : un style de négociation basé sur la coercition plutôt que sur le compromis
Le président Donald Trump se présente comme un faiseur de deals, mais son style de négociation repose davantage sur les ultimatums que sur le compromis. Cette semaine encore, il a imposé des tarifs douaniers à des partenaires commerciaux plutôt que de s'engager dans des négociations prolongées. Il a également accru la pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle baisse les taux d'intérêt, tout en lançant une enquête sur l'enseignement supérieur afin de remodeler les universités à sa guise. Pour Trump, un accord n'est pas synonyme de compromis, mais plutôt une occasion d'imposer sa volonté.
Bien qu'il recule parfois face à ses menaces, la semaine passée a rappelé que celles-ci sont une caractéristique permanente de sa présidence. Alors qu'il renforce son emprise sur les institutions indépendantes, les contrepouvoirs à son autorité se réduisent. Les républicains au Congrès craignent des défis électoraux soutenus par le président, et la Cour suprême est désormais majoritairement composée de ses nominés.
Interrogé récemment sur les négociations commerciales, Trump a résumé sa philosophie : « Ce n'est pas eux qui fixent les règles, c'est moi. » Ses alliés estiment que son agressivité est nécessaire dans un environnement politique où il est assiégé par les démocrates, le système judiciaire et les médias. Pour eux, le président tente simplement de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu.
Mais ses détracteurs craignent qu'il ne sape les fondements démocratiques du pays avec un style autoritaire. Selon eux, son obsession pour les négociations masque une volonté de domination et d'expansion de son pouvoir. « Le pluralisme et l'autonomie des institutions – entreprises, système judiciaire, organisations à but non lucratif – sont essentiels à la démocratie », souligne Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor. « Cette diversité est menacée par des méthodes brutales et coercitives. »
L'enseignement supérieur dans le viseur
Harvard est une cible privilégiée de Trump depuis avril, lorsqu'il a exigé des réformes de gouvernance et de nouveaux professeurs pour contrer ce qu'il perçoit comme un biais libéral. Face à la résistance de l'université, son administration a supprimé 2,2 milliards de dollars de subventions fédérales – des fonds vitaux pour la recherche sur le cancer, Parkinson, les voyages spatiaux ou les pandémies. Trump a aussi tenté d'empêcher Harvard d'accueillir 7 000 étudiants étrangers et menacé de lui retirer son statut d'exonération fiscale. Des subpoenas ont récemment été envoyés pour obtenir des données étudiantes. « Ils finiront par céder », a-t-il affirmé.
En mars, l'Université de Pennsylvanie a perdu 175 millions de dollars dans une polémique sur le sport féminin, avant de les récupérer en modifiant ses politiques concernant la nageuse transgenre Lia Thomas. Columbia a plié après le retrait de 400 millions de subventions, acceptant notamment de placer son département d'études moyen-orientales sous supervision. À l'Université de Virginie, le président James Ryan a démissionné sous la pression après une enquête du ministère de la Justice. Une enquête similaire a été ouverte à l'Université George Mason. « Le financement fédéral est un privilège, pas un droit », a déclaré Kush Desai, porte-parole de la Maison Blanche. Ces mesures étaient impensables avant l'ère Trump.