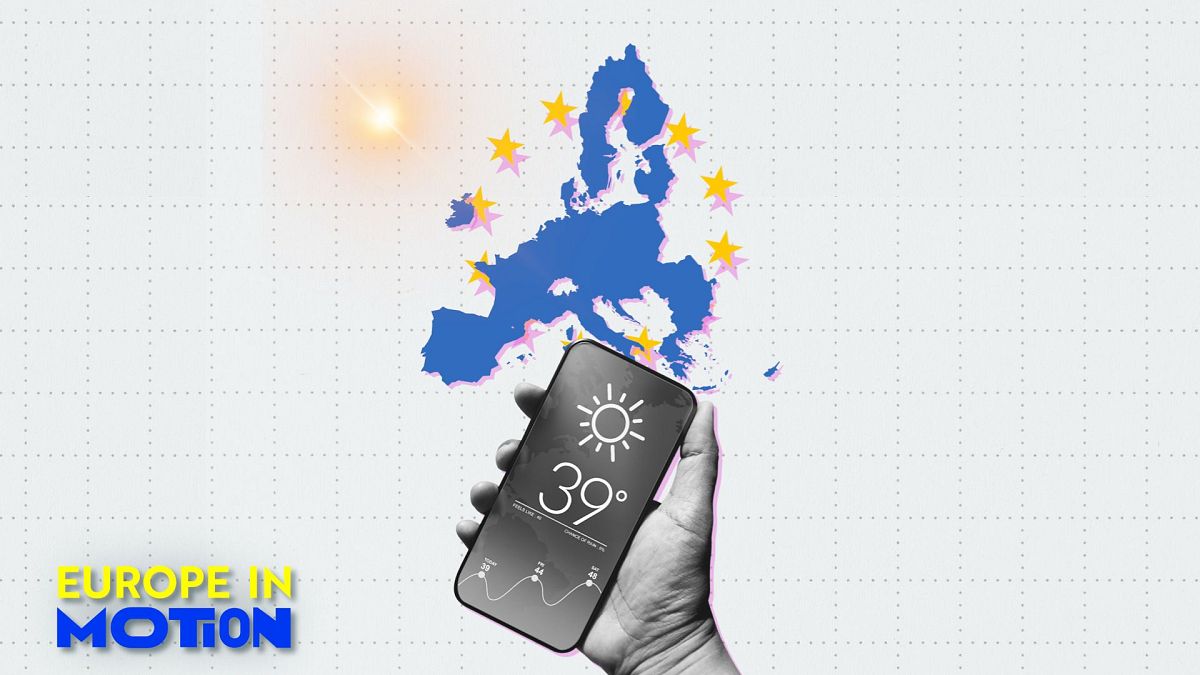Le Mexique des années 1860 : une vision alternative de l'ordre libéral international
En 1867, les dirigeants les plus puissants du monde, dont l'empereur autrichien Franz Josef, Napoléon III de France et le secrétaire d'État américain William H. Seward, ont imploré le gouvernement mexicain d'épargner la vie d'un condamné. Le Mexique, avec son armée disparate, venait de vaincre la France, alors première puissance terrestre européenne. Cette campagne coûteuse de six ans a vidé les caisses françaises et affaibli le soutien intérieur à Napoléon III. Son projet de transformer le Mexique en un empire client sous Maximilien Ier, un archiduc Habsbourg né à Vienne, s'est soldé par un échec retentissant. Capturé, Maximilien fut jugé par un tribunal militaire mexicain. Considéré comme un pair par les monarchies européennes, il fut condamné comme un envahisseur pirate, un usurpateur et un traître par les libéraux mexicains. Malgré les protestations indignées des cours européennes, le président Benito Juárez refusa de commuer sa peine. L'empereur autoproclamé fut exécuté par un peloton d'exécution.
Cette controverse dépassait le sort d'un monarque. Elle cristallisait un conflit entre deux visions opposées de l'ordre mondial, comme l'avait déclaré le président péruvien Ramón Castilla : une « guerre des couronnes contre les bonnets de la liberté ». Aujourd'hui, la politique mondiale est en pleine mutation. L'ordre international libéral, fondé sur le multilatéralisme, les marchés ouverts, les droits de l'homme et l'État de droit, traverse sa crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, autrefois fervents défenseurs, bafouent ouvertement le droit international et sapent les normes qu'ils avaient promues. La Chine reste ambivalente, tandis que la Russie accélère sans complexe le délitement de cet ordre. Plus largement, l'ancien ordre d'après-guerre semble en décalage avec le Sud global et la colère suscitée par les doubles standards révélés par les guerres en Ukraine, à Gaza et en Iran. Face aux crises actuelles, un ordre mondial conçu par et pour les grandes puissances paraît à la fois insuffisant et voué à manquer de légitimité. Une réorganisation nécessitera le soutien d'acteurs divers, y compris des États du Sud global.
Les années 1860 furent une décennie turbulente, souvent négligée, de réorganisation mondiale. Les bouleversements technologiques – télégraphe, électricité, bateaux à vapeur et chemins de fer – semblaient aussi disruptifs que l'IA aujourd'hui. Combinés à des dynamiques de pouvoir changeantes, ces transformations ont accéléré l'expansion impériale. Pourtant, les règles du nouvel ordre demeuraient incertaines, même parmi les puissances impériales. En Europe, les réseaux de pouvoir dynastique pesaient encore en politique internationale. Sous pression croissante, l'ancien régime cherchait à se réinventer et à s'affirmer. Les vieux empires justifiaient souvent leur expansion en promettant d'apporter ordre et progrès.