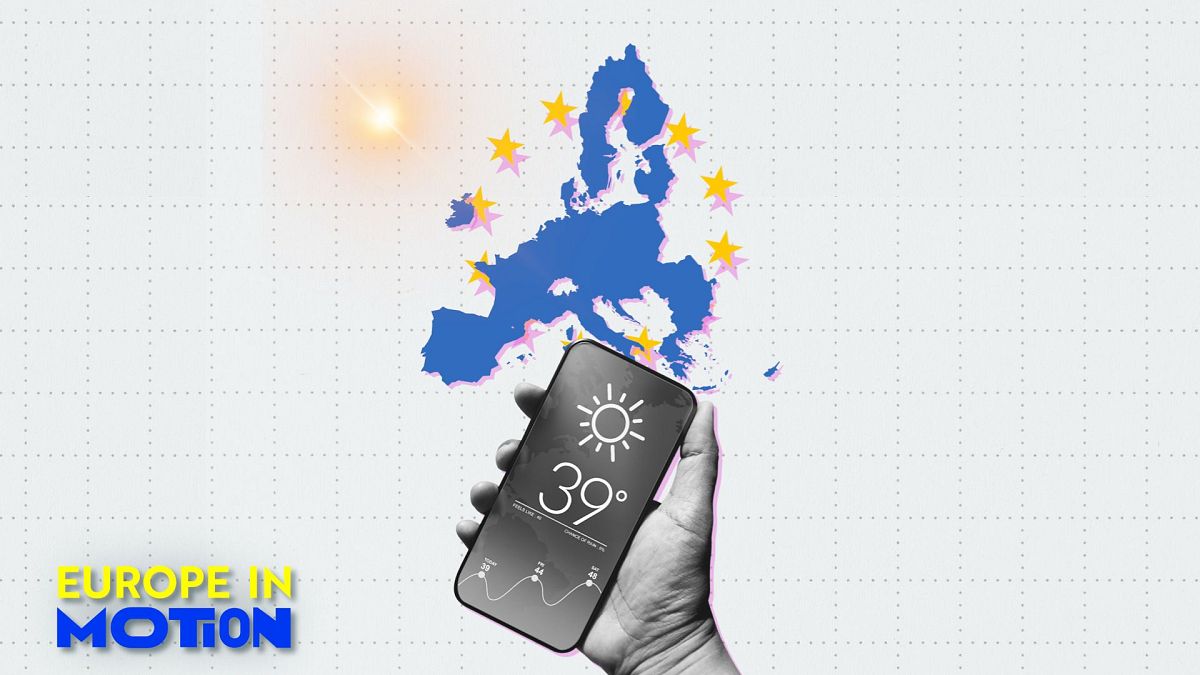Pourquoi l'Europe ne parvient pas à dompter l'extrême droite ?
La crise migratoire de 2015 continue de peser sur l'Europe. L'afflux de plus de 1,3 million de demandeurs d'asile, principalement originaires de Syrie, d'Afghanistan et d'Irak, a alimenté le populisme européen et renforcé ses figures les plus talentueuses. Cette situation a engendré une anxiété culturelle et économique qui a transformé le paysage politique du continent. Pourtant, la montée de l'extrême droite au cours des dix dernières années reste marquée par des limites significatives.
En Allemagne, le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) a étendu son influence régionale et fédérale, mais les autres grands partis refusent toujours toute collaboration politique avec lui. En France, Marine Le Pen parvient régulièrement au second tour des élections présidentielles, mais échoue à remporter la victoire. En Italie, Giorgia Meloni est devenue en 2022 la première populiste anti-immigration à gagner une élection majeure en Europe, mais sa coopération avec Bruxelles et son soutien à l'Ukraine l'ont éloignée des stéréotypes de l'extrême droite.
Au Royaume-Uni, Nigel Farage, champion du Brexit, est en tête des sondages, mais la victoire aux prochaines élections générales en 2029 reste incertaine. Par ailleurs, des gouvernements centristes ont émergé cette année en Allemagne et en Roumanie, malgré la montée de l'extrême droite. À l'inverse, le gouvernement néerlandais dirigé par le Parti pour la liberté (extrême droite) s'est effondré en juin, et le Parti de la liberté autrichien n'a pas réussi à former une coalition malgré sa victoire en septembre.
Pour l'instant, les institutions européennes résistent bien. Les partis pro-UE dominent toujours la politique à Bruxelles, et le risque que les eurosceptiques créent des blocages reste faible. Au Parlement européen, la coalition centriste soutenant Ursula von der Leyen pour un second mandat à la présidence de la Commission européenne devrait tenir malgré les tensions. Au Conseil européen, seuls quatre des 27 membres (Hongrie, Slovaquie, Italie et République tchèque) sont dirigés par des gouvernements nationalistes.
Bruxelles a finalement réussi à limiter l'influence des gouvernements d'extrême droite sur les politiques de l'UE, et Meloni ainsi que le Premier ministre tchèque Petr Fiala coopèrent étroitement avec von der Leyen. Cependant, les prochaines années pourraient offrir des opportunités majeures à l'extrême droite anti-migrants et eurosceptique.
Les questions sur la résilience économique et la persistance de prix élevés continuent d'alimenter l'anxiété des électeurs. Bien que les politiques migratoires aient été durcies et que le nombre de demandeurs d'asile ait diminué, la présence à long terme des migrants dans des économies stagnantes nourrit toujours la colère des électeurs. Les pressions économiques liées à la guerre commerciale de Donald Trump exacerbent également la frustration envers les gouvernements actuels.
En résumé, rien n'indique que les partis et politiciens d'extrême droite vont disparaître ou cesser de progresser aux dépens des partis centristes affaiblis. Dans deux ans, ces partis auront une occasion historique de capitaliser sur la colère grandissante des électeurs lors des élections nationales en France, Italie, Espagne et Pologne.
En France, bien que Marine Le Pen soit actuellement empêchée de se présenter à la présidence en raison d'une condamnation pour détournement de fonds, son Rassemblement national pourrait finalement accéder au pouvoir. En Italie, Meloni sera sous pression pour adopter des positions plus eurosceptiques avant les élections. En Espagne, le Parti populaire (centre-droit) pourrait devoir former une coalition avec le parti d'extrême droite Vox. En Pologne, l'affaiblissement du soutien au Premier ministre Donald Tusk pourrait ouvrir la voie à un retour des partis nationalistes de droite.
Ces évolutions pourraient modifier l'équilibre des pouvoirs en faveur des populistes, transformant durablement le paysage politique européen.