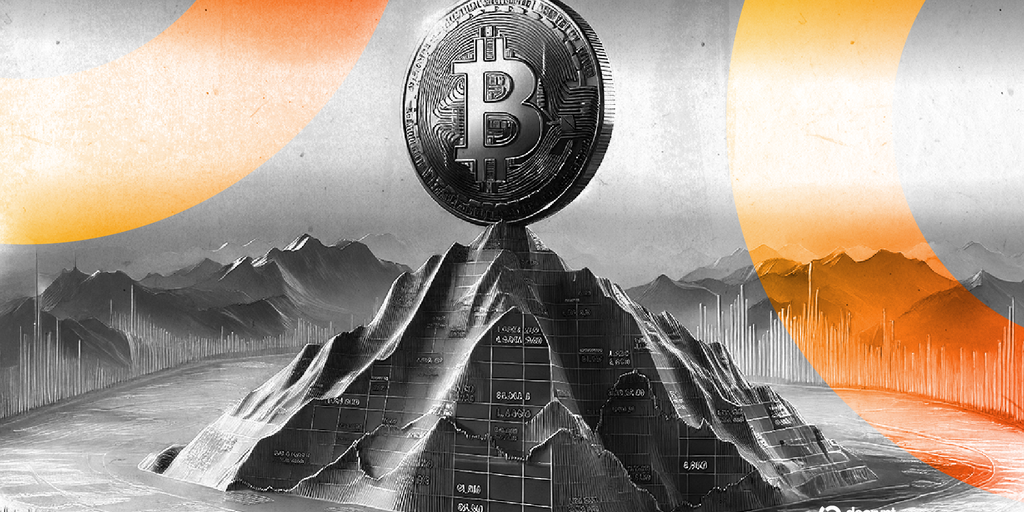Comment une seule frappe a ébranlé l'illusion de stabilité du Golfe
Les monarchies pétrolières du Golfe dépensent des milliards dans des domaines variés : intelligence artificielle, clubs de football, villes futuristes, et influence politique. Pourtant, aucune richesse ne peut effacer leur peur ancestrale d'être pris en étau entre leur garant de sécurité, les États-Unis, et leur rival régional, l'Iran. Le 23 juin, cette crainte est devenue réalité lorsque l'Iran a lancé des missiles balistiques sur la base aérienne américaine d'Al Udeid au Qatar, en représailles aux frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens. Cette attaque sans précédent a révélé la vulnérabilité des États du Golfe, pris entre deux feux.
L'Iran, isolé après la révolution de 1979, a construit un État sécuritaire multiconnecté et relancé son programme nucléaire. Les monarchies du Golfe, elles, ont externalisé leur sécurité sous parapluie américain. La frappe iranienne a montré les limites de cette dépendance, malgré leurs efforts de diversification. Le Qatar, pourtant proche de l'Iran, a dû compter sur les batteries anti-missiles Patriot américaines pour se défendre.
L'impuissance des pays du Golfe a été criante : l'Iran n'a même pas consulté le Qatar, les Émirats ou l'Arabie saoudite avant l'attaque. Seuls les États-Unis ont été informés. Ces monarchies se présentent comme des havres de stabilité, mais cet incident a rappelé que leur prospérité reste liée à une sécurité fragile. La fermeture temporaire de l'espace aérien a affecté leur statut de hubs régionaux, tandis que les entreprises surveillaient nerveusement la situation.
La réponse des pays du Golfe s'est limitée à des condamnations verbales. Toute réaction militaire aurait risqué une escalade ou un désaveu de Donald Trump. Historiquement, la rivalité entre l'Iran et les monarchies du Golfe remonte à avant la révolution islamique, mêlant facteurs politiques, religieux et économiques. La création de la République islamique en 1979 a exacerbé ces tensions, avec l'appel de Khomeini à exporter la révolution.
Après l'échec de l'occupation américaine en Irak et les Printemps arabes, l'Iran a étendu son influence. Les monarchies du Golfe ont financé la contre-révolution et tenté de contrer Téhéran. L'Iran a alors adopté une approche diviser pour mieux régner, se rapprochant d'Oman et du Qatar tout en maintenant des relations hostiles avec l'Arabie saoudite et les Émirats.
L'accord nucléaire de 2015 a divisé la région : l'Arabie saoudite et les Émirats l'ont vivement critiqué, tandis que le Qatar et Oman l'ont accueilli favorablement. Le retrait américain de l'accord en 2018 sous Trump a ravivé les tensions. Les attaques contre des installations pétrolières saoudiennes en 2019 et des sites émiratis en 2022 ont montré la vulnérabilité de ces pays, malgré la protection américaine.
Aujourd'hui, la confiance des monarchies du Golfe envers les États-Unis est au plus bas. Leur désir de diversifier leurs alliances, notamment avec la Chine et la Russie, s'est renforcé. La récente frappe iranienne a relancé le débat sur la présence des bases américaines dans la région. Bien que dépendants de la protection américaine, ces pays réalisent amèrement que leur stabilité reste à la merci des conflits régionaux.