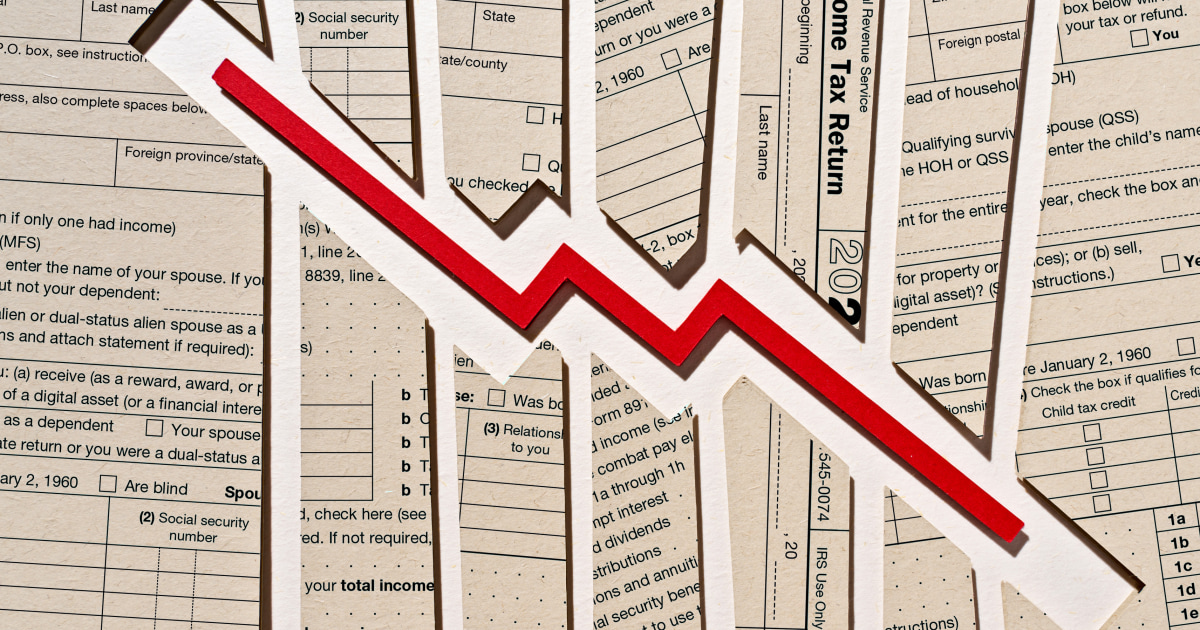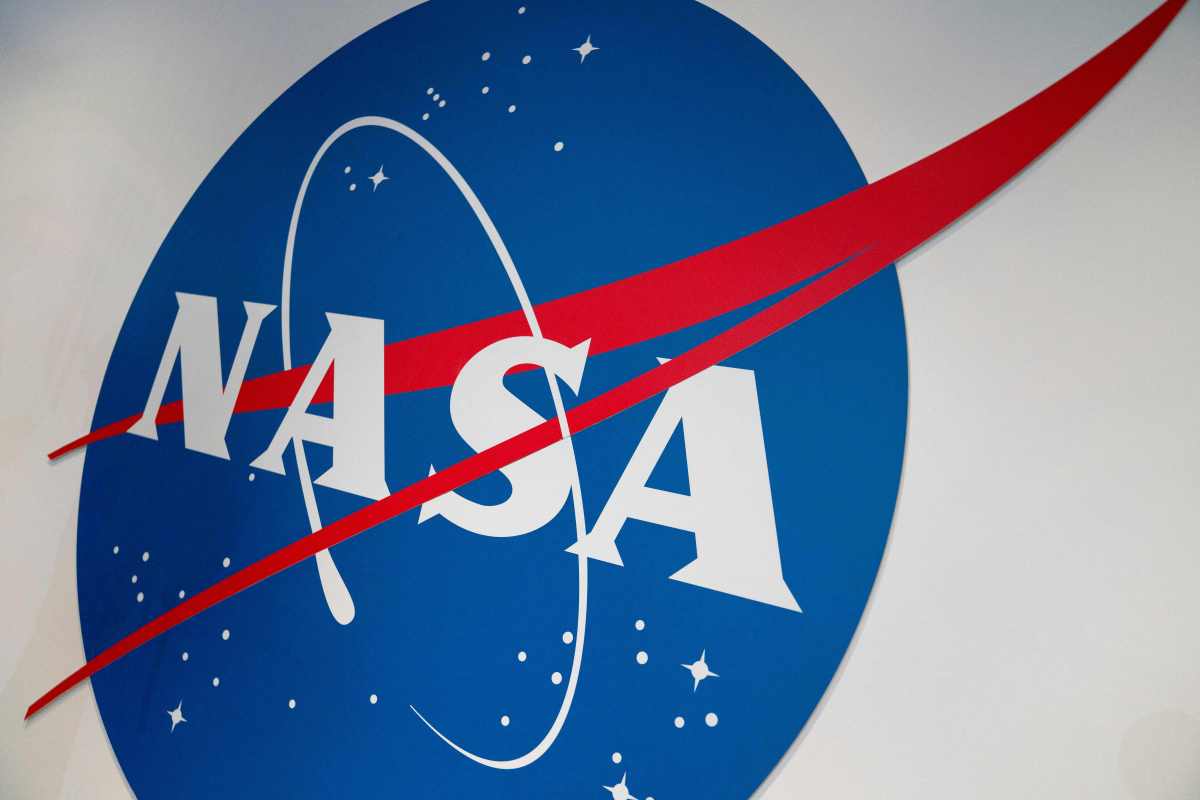La France dit non à l'ultra-fast fashion. Le monde suivra-t-il son exemple ?
La France, considérée comme la capitale mondiale de la mode, prend des mesures audacieuses pour réguler l'industrie. Ce mois-ci, le pays a renforcé sa lutte contre la fast fashion en modifiant une loi climatique pour imposer des pénalités aux géants de l'ultra-fast fashion comme Shein et Temu. Cette initiative marque un tournant dans la régulation d'un secteur longtemps laissé à lui-même.
La nouvelle législation cible spécifiquement les modèles économiques basés sur l'hyperproduction et la surconsommation. Elle prévoit des amendes progressives et des restrictions publicitaires pour les marques promouvant des vêtements jetables à bas prix. Bien que cette loi ne s'applique pas uniformément à toutes les enseignes de fast fashion, elle envoie un signal fort à l'industrie.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre des lois anti-gaspillage et pour une économie circulaire en vigueur depuis 2020. Elle vise particulièrement Shein et Temu, dont les modèles algorithmiques génèrent des milliers de nouveaux styles à des prix dérisoires. En 2024, Shein a réalisé un chiffre d'affaires de 38 milliards de dollars, illustrant l'ampleur du phénomène.
Le secteur de la mode représente environ 10% des émissions mondiales de carbone et produit plus de 90 millions de tonnes de déchets textiles annuels. Face à ce constat, la France montre que les engagements volontaires des marques et la pression des consommateurs ne suffisent plus. Une intervention réglementaire devient nécessaire.
Cependant, cette loi n'est qu'un premier pas. Les amendes restent modestes (quelques euros par article) et son application soulève des questions. Par ailleurs, elle ne remet pas en cause les pratiques des grandes enseignes traditionnelles comme Zara ou H&M, bien que leur modèle repose également sur une production rapide et une main-d'œuvre bon marché.
Cette initiative française pourrait inspirer d'autres pays. À New York, un projet de loi similaire, le Fashion Sustainability and Social Accountability Act, propose d'imposer des obligations de transparence et des objectifs environnementaux aux grandes marques. Le mouvement semble s'amorcer, mais le chemin vers une mode véritablement durable reste long.
Pour les marques, c'est un signal clair : l'ère de la croissance infinite grâce à des vêtements jetables touche à sa fin. Les investisseurs doivent désormais considérer le risque réglementaire comme un facteur clé. Quant aux consommateurs, ils devront s'adapter à une offre moins abondante et potentiellement plus chère.
La régulation seule ne suffira pas à résoudre les problèmes structurels de surproduction et de surconsommation qui caractérisent l'industrie de la mode mondiale. Mais en tant que première mesure concrète d'un grand pays de la mode, la loi française ouvre une voie que d'autres pourraient suivre. Le véritable changement, cependant, exigera des efforts bien plus importants et coûteux que ces premières mesures.