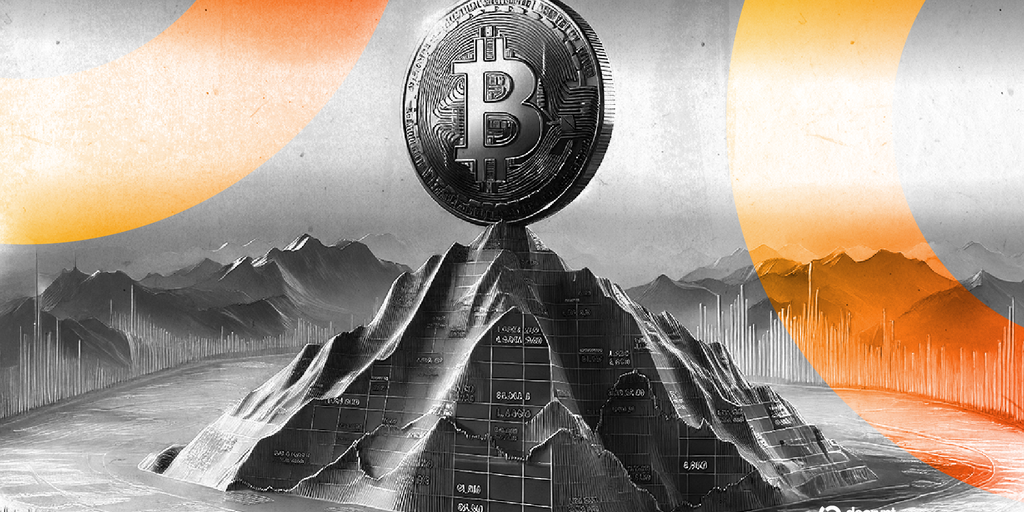Les États-Unis : un État en déliquescence sous des apparences trompeuses
Les États-Unis, malgré leur image de puissance incontestée, sont un État en pleine déliquescence. Conçue à l'origine pour treize colonies agricoles, leur structure institutionnelle est aujourd'hui inadaptée à une nation de 330 millions d'habitants gérée par des plateformes numériques et des modèles prédictifs. Les institutions persistent en apparence, mais leur capacité d'action s'est atrophiée, laissant place à une continuité purement performative.
Selon les critères scientifiques - perte de capacité étatique, érosion de la légitimité, incapacité à fournir des services de base - les États-Unis ont déjà échoué. Ce déclin ne date pas de l'ère Trump, mais s'inscrit dans un processus engagé depuis des décennies. L'indice des États fragiles du Fund for Peace, pourtant, ne reflète pas cette réalité, car il ne prend pas en compte le soft power américain.
L'incapacité bureaucratique est devenue une caractéristique nationale. Le projet de train à grande vitesse californien, lancé dans les années 1980, a englouti 100 milliards de dollars sans relier San Francisco à Los Angeles. En comparaison, la Chine a construit 40 000 km de lignes à grande vitesse dans le même laps de temps. Ce contraste ne relève pas d'une simple question de régime politique, mais d'un rapport différent à la modernité.
Le monopole de la violence légitime, principe fondamental de l'État selon Max Weber, s'est transformé en un système fragmenté et inégal. Les 18 000 agences de police américaines opèrent avec des règles disparates, créant des zones de non-droit où l'arbitraire règne. Le meurtre de George Floyd n'était pas une exception, mais l'illustration d'une violence systémique.
L'État américain souffre d'une illisibilité croissante. Des systèmes informatiques vieux de quarante ans gèrent des fonctions vitales comme les élections ou les allocations chômage. Lorsque le système californien d'indemnisation du chômage a craqué pendant la pandémie, 30 milliards de dollars ont été perdus à cause de fraudes - non par corruption, mais par incompréhension du code source.
Trois piliers maintiennent l'illusion : le dollar comme monnaie de réserve mondiale, le mythe de l'exceptionnalisme américain, et une interface démocratique qui masque la corruption du système. Cette 'faillite veloutée' permet à l'Amérique de poursuivre son déclin en douceur, comme une application au design soigné mais au code défaillant.
La fragmentation culturelle rend toute action collective impossible. Différentes visions de l'Amérique - empire, expérience ratée, corporation militarisée - coexistent sans se concilier. Quand un pays ne peut plus mettre à jour sa réalité partagée, il continue mécaniquement... jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. L'effondrement ne sera pas spectaculaire, mais procédural : bâtiments décrépits, pénuries d'antibiotiques, procédures interminables. L'Amérique ne deviendra pas le Venezuela, mais quelque chose de plus étrange encore : un État qui joue parfaitement son rôle tout en ayant oublié comment fonctionner.